nouveau ! hotline QUALITE :
qualiopi en 1 clic
Le TOP4 des non conformités Qualiopi les plus fréquentes
Qualiopi version 9 : des attentes clarifiées, mais toujours les mêmes pièges. Explorez comment les contourner." Les audits Qualiopi ne pardonnent pas l’improvisation. Avec la version 9 du RNQ, les attentes sont plus précises, mais certaines non-conformités (NC) restent des écueils récurrents. Chaque année, elles coûtent du temps et de la crédibilité aux organismes de formation.
AUDIT QUALIOPI
l'équipe qualité
1/21/20256 min lire

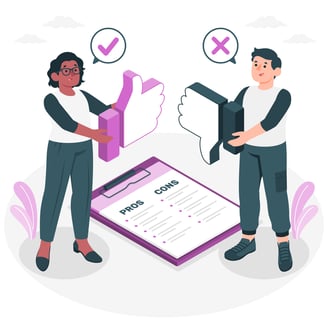
Qualiopi version 9 : des attentes clarifiées, mais toujours les mêmes pièges. Explorez comment les contourner.
Les audits Qualiopi ne pardonnent pas l’improvisation.
Avec la version 9 du RNQ, les attentes sont plus précises, mais certaines non-conformités (NC) restent des écueils récurrents. Chaque année, elles coûtent du temps et de la crédibilité aux organismes de formation.
Voici le TOP 4 des Nc les plus fréquentes
TOP 1
Des indicateurs de performance clairs pour une conformité sans faille
L’indicateur 02 de Qualiopi impose un minimum de deux indicateurs de performance par prestation. Parmi les options les plus courantes : la satisfaction des stagiaires et les résultats obtenus au regard des objectifs du programme. Mais ce n’est que le point de départ. La clé ? Adapter ces indicateurs à la structure de votre catalogue pour refléter précisément vos activités.
Un indicateur global pour un thème unique.
Si votre organisme propose plusieurs formations dans un domaine spécifique, comme le management, un indicateur global sur l’atteinte des objectifs suffit. Par exemple, une seule mesure couvrant 30 formations en management peut être publiée sur votre site. Cela simplifie votre communication tout en restant conforme.
Des indicateurs thématiques pour une offre diversifiée.
Si votre catalogue couvre plusieurs thématiques distinctes – comme le management, les ressources humaines, ou le digital – chaque thème doit être accompagné d’un indicateur spécifique. Cela garantit une vision claire et détaillée pour vos parties prenantes, tout en respectant les exigences de transparence.
Personnalisation et précision, vos alliées.
Au-delà des indicateurs globaux, il est fortement recommandé de détailler les données à l’échelle des programmes. Indiquer, par exemple, le taux de satisfaction ou le taux de réussite pour chaque formation dans une thématique donnée renforce votre crédibilité et valorise la qualité de votre offre.
Comment éviter les écueils ?
Prenez le temps de structurer vos indicateurs selon vos activités. Analysez vos thématiques, identifiez les données disponibles, et vérifiez leur pertinence. Un tableau simple, régulièrement mis à jour, peut suffire à garantir votre conformité tout en facilitant vos audits.
Vos indicateurs reflètent-ils votre réalité ?
Prenez un moment pour évaluer vos données. Qu’il s’agisse d’un thème unique ou de plusieurs domaines, chaque indicateur doit être pensé pour valoriser votre travail et répondre aux attentes des audits. Quels sont vos outils pour les gérer efficacement ?
TOP 2
Adapter vos évaluations d’entrée en formation : une clé de conformité et d’efficacité
L’évaluation d’entrée en formation est un levier essentiel pour adapter l’enseignement aux besoins des apprenants. Mais comment bien structurer cette étape, surtout face à des formations variées en durée et en objectif ?
Des solutions adaptées pour les formations courtes.
Pour une formation courte et non qualifiante, comme une session de 7 heures sur le perfectionnement de soft skills, un simple quizz de positionnement suffit. Ce quizz, conçu pour vérifier les connaissances initiales des apprenants par rapport aux objectifs de la formation, est un outil pratique et rapide. Mais l’évaluation ne s’arrête pas là : intégrer des moments de mise en pratique, suivis de débriefings individualisés, renforce l’adéquation entre la formation et les attentes spécifiques des stagiaires.
Une évaluation approfondie pour les formations certifiantes.
Dans le cadre de formations plus longues et certifiantes, l’évaluation d’entrée doit être plus détaillée. Cela inclut des entretiens individuels approfondis pour cerner les besoins et objectifs spécifiques de chaque apprenant, des tests variés pour évaluer les acquis, et un compte-rendu détaillé des conditions d’apprentissage requises. Cette démarche garantit une optimisation de l’enseignement et un suivi rigoureux de la progression.
Une ingénierie pédagogique pour tous.
Quel que soit le type de formation, une ingénierie pédagogique bien pensée est indispensable. Cela implique de structurer les évaluations, de planifier des retours réguliers et de créer des dispositifs qui démontrent la capacité de l’organisme à répondre aux besoins spécifiques des stagiaires. Ces pratiques favorisent non seulement la satisfaction des apprenants, mais aussi la conformité aux exigences Qualiopi.
Pourquoi cette distinction est essentielle ?
Un processus d’évaluation proportionné à la durée et aux objectifs de la formation renforce la crédibilité de votre organisme. Cela montre à la fois votre professionnalisme et votre capacité à vous adapter à des contextes variés.
Et vous, vos évaluations sont-elles adaptées ?
Qu’il s’agisse d’un quizz rapide ou d’un dispositif complet, chaque formation mérite une évaluation en phase avec ses enjeux. Quels outils utilisez-vous pour garantir une adéquation optimale entre les besoins des apprenants et votre offre ?
TOP 3
Optimiser la gestion des veilles pour éviter les non-conformités
Les non-conformités liées à la veille restent fréquentes, souvent en raison d’un manque de démonstration dans deux domaines clés : la communication interne des informations recueillies et l’exploitation effective des veilles dans les pratiques pédagogiques ou administratives de l’organisme.
Démontrer l’exploitation des veilles : un impératif
Exploiter les résultats de la veille ne signifie pas uniquement collecter des données, mais les transformer en actions concrètes ou réflexions appliquées. Par exemple, l’utilisation d’une solution d’intelligence artificielle pour concevoir des supports pédagogiques peut permettre aux formateurs de consacrer davantage de temps au suivi individualisé des stagiaires en difficulté, ou de proposer des exercices et modules adaptés à leurs besoins spécifiques.
Automatiser pour gagner en efficacité
La veille sectorielle peut être gérée via des plateformes comme Digiforma, qui automatisent le recueil d’informations tout en enrichissant leur contenu. Cette approche réduit le temps mobilisé par le personnel, tout en garantissant un accès structuré et pertinent aux nouveautés réglementaires et sectorielles.
Réunions d’échanges : un outil clé
Organiser des réunions d’échanges de pratiques, avec un compte-rendu précis, permet de démontrer l’intégration de la veille dans les processus de réflexion et d’amélioration. Par exemple, choisir un sujet issu de la veille à analyser collectivement, même si celui-ci n’aboutit pas à une modification immédiate des programmes de formation, reste une preuve d’exploitation pertinente.
Une obligation adaptée aux réalités du terrain
Avec la version 9 du RNQ, les exigences en matière de veille sectorielle et d’innovations pédagogiques intègrent une certaine flexibilité. Toutes les informations collectées n’ont pas vocation à modifier systématiquement les contenus de formation chaque année. L’exploitation des veilles doit être proportionnée à l’activité de l’organisme et à la pertinence des nouveautés par rapport aux thématiques des formations.
Pour éviter les écueils : structurez votre démarche
Communiquez régulièrement les résultats des veilles en interne, via des réunions ou des supports dédiés.
Suivez un plan d’action pour intégrer progressivement les innovations pertinentes.
Documentez chaque étape : de la collecte des données à leur exploitation éventuelle, en passant par les échanges d’équipe.
En cas de doute pensez à utiliser notre service répondre à une question
Et vous, votre veille est-elle un levier ou une contrainte ?
Que faites-vous pour exploiter efficacement vos veilles tout en optimisant le temps de vos équipes ?
TOP 4
Actions correctives : de l’intention à la démonstration
L’un des écueils fréquents en audit concerne la gestion des actions correctives. Si elles sont notées sur un Tableau d’Amélioration Continue Qualité (TACQ) mais ne donnent lieu à aucune action concrète, elles peuvent engendrer une non-conformité. L’essentiel n’est pas seulement d’identifier un dysfonctionnement, mais de démontrer que des mesures ont été prises pour le résoudre.
Noter, c’est bien. Agir, c’est mieux.
Documenter les manquements ou aléas dans un TACQ est une étape importante, mais elle doit être suivie de traitements effectifs. Une action corrective, qu’elle soit préventive ou curative, doit être traçable et permettre de montrer que le problème a été réglé, ou qu’un processus a été ajusté pour éviter sa réapparition.
Prendre le temps de l’amélioration continue
Pour éviter que les actions correctives ne restent à l’état d’intention, il est crucial de réserver des temps dédiés à la gestion de la qualité. Organiser un comité de pilotage qualité une à deux fois par an est une solution simple et efficace pour examiner les points relevés, décider des actions à mener et évaluer leur mise en œuvre. Ces moments permettent également de sensibiliser les équipes à l’importance d’une gestion rigoureuse et collaborative de la qualité.
S’organiser pour mieux gérer
Formalisez vos actions : Assurez-vous que chaque remarque inscrite sur le TACQ soit accompagnée d’une action corrective définie, avec une personne responsable et un délai fixé.
Planifiez vos réunions qualité : En les organisant à intervalle régulier, vous donnez un cadre structuré à la gestion des améliorations.
Documentez les résultats : Conservez des traces des actions entreprises et de leur efficacité pour les présenter en audit.
Et si la régularité pose problème ?
Si vous manquez de temps ou de ressources pour structurer votre démarche qualité, envisager des solutions externalisées peut être une réponse adaptée. Celles-ci permettent d’assurer une gestion continue et d’éviter les non-conformités liées aux actions correctives non tracées. Si vous n’arrivez pas à être régulier sur cette gestion qualité, notre offre déléguer la gestion qualité peut répondre à votre besoin
Votre amélioration continue est-elle sur les bons rails ?
Quels moyens mettez-vous en place pour transformer vos constats en améliorations réelles et démontrables ?
Et vous, quelles sont vos astuces pour éviter les NC en audit ?
Partagez vos bonnes pratiques ou vos retours d’expérience pour enrichir cette discussion !
© 2024.tous droits réservés
Expertise en certification
et ingénierie pédagogique
Equipe d'auditeurs Qualiopi
CONSEIL QUALIOPI
Plan du site
Nous contacter
+33 6 95 46 26 30